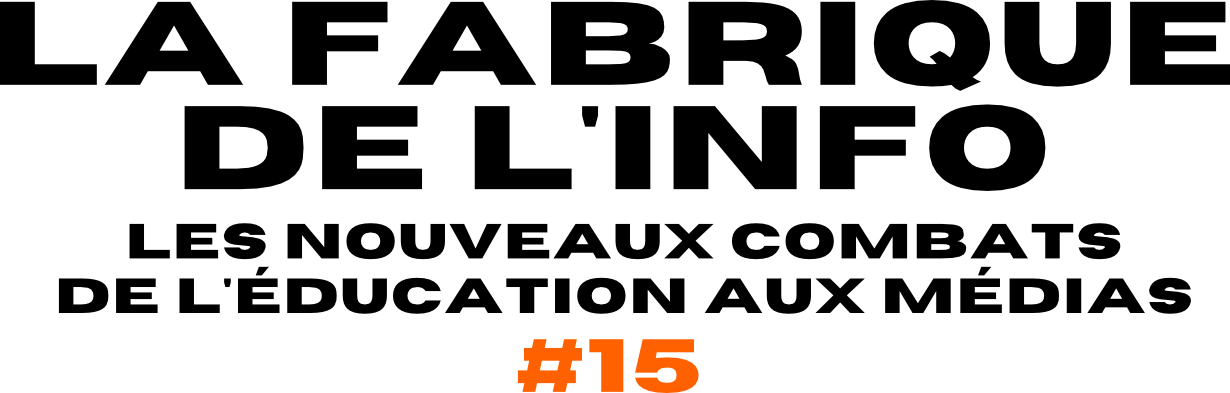Les ateliers d’Éducation aux médias et à l’information (EMI) en milieu carcéral se multiplient ces dernières années. Avec un enjeu tout particulier : lutter contre la désinformation et les fake news, dans les lieux isolés et clos que sont les prisons.
« Pour eux, j’étais la salope qui travaille dans les médias. Dans les merdias, d’ailleurs, si on reprend leur vocabulaire. » Thomas Huchon se souvient du jour où il est intervenu au sein d’un programme de prévention de la radicalisation violente (PPRV) d’un établissement pénitentiaire nantais. Il était venu parler « médias », « fake news », et « désinformation » avec des détenu·es incarcéré·es pour djihadisme ou violences racistes.
Depuis 2015, le journaliste indépendant intervient dans des écoles, collèges et établissements pénitentiaires pour sensibiliser jeunes et moins jeunes à la désinformation et la propagation de fake news sur Internet.
Un accès limité à l’information en prison
Les murs de la prison, Berthet Mahouahoua les connaît bien. En 2006, ce natif de la région parisienne entre, à 30 ans, au centre de détention de Val-Rueil (Eure) après avoir été condamné pour le braquage d’une bijouterie. À sa sortie, cinq ans plus tard, il se lance dans la bande-dessinée sous le nom d’artiste de Berthet « One » et se promet de ne plus remettre un pied en prison, sauf pour témoigner de sa réinsertion.
Pour lui, l’éducation aux médias revêt une importance capitale, car entre les murs de la prison, « toutes les nouvelles qui circulent sont prises pour argent comptant ». L’ancien détenu le sait bien, les personnes incarcérées sont particulièrement exposées à la désinformation. « En détention, l’accès à Internet est restreint. Donc il n’y a pas vraiment d’opportunité de vérifier toutes les informations qui nous parviennent. »
Depuis 2020, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) réclame le droit à un accès internet pour toutes et tous. En réalité, de nombreux·ses détenu·es contournent déjà les règles et se procurent des smartphones. « Ils s’informent via Snapchat, Instagram mais aussi TikTok pour les plus jeunes », explique Margot Hemmerich, journaliste indépendante qui dispense elle aussi des ateliers d’EMI en milieu carcéral.
Dans tous les lieux de privation de liberté, « le droit à l’information est un droit fondamental », rappelle Yanne Pouliquen, contrôleuse et déléguée à la communication du CGLPL. Y sont distribués certains titres de presse quotidienne régionale comme Le Progrès en région lyonnaise ou Ouest-France pour le centre de détention de Nantes. Mais Basile de Bure, journaliste indépendant et auteur de l’essai Que le destin bascule, récit de ses ateliers d’EMI auprès de ces publics, nuance l’utilité de cet accès : « la presse papier, ce n’est pas l’information vers laquelle les détenus se tournent naturellement. »
Stigmatisé·es par les médias
Et s’ils et elles ne se sentent que peu concerné·es par les médias, c’est sans doute parce qu’ils y sont représentés de manière stigmatisante, souvent. « Ils ont l’intuition que quelque chose se joue autour de leur identité, car ce sont majoritairement des personnes non-blanches, dont beaucoup sont de confession musulmane. Mais ils attribuent ce climat de stigmatisation aux politiques, estimant que « ce sont tous des racistes », et non aux médias qui véhiculent ces clichés. Par exemple, ils ne connaissent pas Valeurs Actuelles », explique Basile de Bure.
Les personnes incarcérées ont également accès aux chaînes de télévision gratuites. Cela leur permet de tuer le temps et de rester informé·es de l’actualité. Dans les cellules, nombreux·ses sont les détenu·es branché·es sur certaines chaînes d’information en continu. Des chaînes qui, pourtant, véhiculent des clichés sur elles et eux et les lieux d’où ils et elles viennent. L’ARCOM (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) épingle régulièrement les chroniqueur·ices pour propos racistes et islamophobes, entre autres. C’est le cas d’Eric Zemmour, condamné par la justice, en janvier 2023.
Les deux journalistes ont constaté les mêmes paradoxes. Bien que les prisonnier·ères soient tous·tes devant BFM TV, CNews ou encore Touche pas à mon poste, ils et elles se montrent pourtant très critiques de la façon dont sont traitées les banlieues, l’Islam et les violences policières.
Margot Hemmerich s’efforce de leur présenter un journalisme qui les représente davantage, en leur proposant des médias comme StreetPress, ou sous différentes formes, par exemple la bande dessinée.
La « mécanique psychosociale » du complot
Thomas Huchon voit dans la détention « un terreau fertile pour la pensée complotiste ». Sans dire que les détenu·es adhèrent toutes et tous aux théories du complot, ce spécialiste des fake news souligne qu’il existe, dans l’univers carcéral, « une mécanique mentale qui s’installe et qui facilite l’adhésion à des récits complotistes ».
Pour Basile de Bure, la plupart des personnes incarcérées ou sous main de justice, expliquent et reconnaissent « avoir fait de la merde », mais d’autres au contraire cherchent un bouc émissaire : parfois ce sont les francs-maçons, d’autres les Juif·ves, etc. Et si ces personnes adhèrent à ces théories, c’est avant tout parce qu’elles n’ont pas les clés de compréhension nécessaires pour se figurer la complexité de leur destin. « La théorie de la reproduction sociale de Bourdieu leur est inconnue, explique Basile de Bure, mais avec les théories de Soral et compagnie, une explication simple leur est donnée, permettant de rendre la réalité de leur situation supportable. »
Derrière cette vulnérabilité face aux fake news et aux théories du complot se cache un risque plus grand, celui de la radicalisation. Pour Thomas Huchon « les phénomènes de radicalisation, quelles que soient leur nature, sont liés à une prédisposition aux théories du complot ». Dès lors, l’éducation des détenu·es à l’information devrait être une priorité de l’administration pénitentiaire.
Apprendre à mentir
Dans les ateliers d’EMI qu’il mène, Thomas Huchon fait usage d’une méthode de sensibilisation aux fake news particulière. « Pour commencer, je leur montre un documentaire mensonger, explique-t-il. J’attends de voir s’ils y croient et puis, ensuite, on réfléchit ensemble à la manière dont on s’est fait avoir et ce que l’on peut faire pour que ça ne recommence pas. »
De son côté, Margot Hemmerich adopte une autre technique. Elle prône l’éducation par le faire, autant que cela est possible. Interviews, portraits, micro-trottoir… Les détenu·es s’essayent à divers styles journalistiques, par écrit ou un micro-enregistreur à la main. Ensemble, ils et elles définissent des thématiques qui leur tiennent à cœur et construisent un journal.
« Avec ce public, il faut prendre encore davantage en compte leurs attentes et la réalité de leur quotidien. Parfois, ils ont simplement envie de discuter de leur vie en détention. On ne produit rien mais on échange, de façon très riche, sur la liberté de la presse dans le monde, l’économie des médias ou encore leur indépendance. Je m’appuie sur des supports produits par Reporters sans frontières ou Le Monde Diplomatique. »
L’EMI pour réduire la fracture entre détenu·es et médias
Si, en les isolant, l’environnement de la prison rend les personnes incarcérées plus vulnérables aux fake news, d’autres facteurs doivent aussi être pris en compte selon Thomas Huchon. À commencer par l’origine socio-économique des détenu·es. Il observe que « la majorité d’entre eux viennent de milieux défavorisés où l’accès à la culture et aux études est plus limité ». De ce constat, en découle un autre. Les prisonnier·ères sont éloigné·es de la sphère médiatique et manquent de connaissances sur le monde de l’information. « Quand je leur demande de me citer des journaux, ils me répondent L’Équipe et la rubrique faits divers du Parisien », raconte Basile de Bure. « Pour en mentionner d’autres, c’est plus compliqué… »
Berthet Mahouahoua s’en est aperçu en entrant dans le milieu artistique après sa détention. En découvrant d’autres horizons culturels et sociaux, le gamin de la cité des 4000 de La Courneuve (Seine-Saint-Denis) s’est rendu compte « qu’en prison, comme dans les quartiers, les jeunes sont enclavés. Il y a des réflexes et des savoirs qu’ils n’ont pas ».
Loin d’être fatalistes, Berthet Mahouahoua, comme Thomas Huchon, croient au pouvoir de l’EMI pour permettre à ces populations de développer un regard critique sur l’actualité et leur enseigner « les bons réflexes pour chercher la vérité et débunker les fausses informations ». Les ateliers d’éducation aux médias organisés par l’association Makadam, créée en 2013 par Berthet Mahouahoua et basée en région parisienne, visent précisément à « apprendre aux détenus à chercher et à décomposer eux-mêmes l’actualité ».
Condamné·es à faire plus
Margot Hemmerich le souligne : « la plupart des jeunes que je rencontre sont motivés. Ils ont l’air contents de participer. Ils ont toujours plein de questions à poser donc je me dis qu’ils sont intéressés ». Malgré tout, la journaliste ne peut s’empêcher de s’interroger sur la réelle utilité de ces interventions. Une question que se pose aussi Thomas Huchon. « Des fois, j’ai l’impression que tout le travail que l’on fait, en prison ou ailleurs, ne sert à rien, mais en réalité personne ne peut nous prouver que si l’on ne faisait pas tout ça, ça serait pire. Alors on continue d’y croire. »
Reste que les ateliers d’EMI à destination des populations incarcérées demeurent trop peu fréquents. Pour expliquer ce déficit, une cheffe de service d’une unité éducative en milieu ouvert (UEMO) bordelaise pointe du doigt le manque de moyens humains et financiers de l’administration judiciaire. Dans ces structures pour mineur·es, la priorité des services éducatifs est d’assurer la protection des jeunes placé·es. « Si nous surveillons leur accès à l’information, notamment sur les réseaux sociaux, c’est avant tout dans un souci de sécurité, pour prévenir les risques liés à l’utilisation de ces plateformes. »
La question du lien entre ces jeunes et les médias reste donc « largement impensée », insiste la cheffe de service. En cause : « le manque de temps et de moyens humains » nécessaires pour construire des ateliers d’éducation aux médias.
Les médias et journalistes ont leur part à faire
Depuis 2019, Margot Hemmerich explique que le ministère de la Culture débloque de plus en plus de moyens financiers à destination des journalistes pour mener des ateliers d’EMI. Si cette journaliste, avec le concours de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) et de Rue89 Lyon, a pu mettre en place ces ateliers avec des jeunes en prise avec la justice, c’est en grande partie parce que les structures pénitentiaires concernées n’avaient rien à débourser, mais simplement à valider un projet clé en main.
Les médias et les journalistes ont donc un rôle majeur à jouer dans la prise en compte des publics les plus éloignés d’elles et eux. Apprendre à échanger avec les détenu·es, se confronter à leurs réalités, permettrait en premier lieu de bannir les clichés persistants dont ils et elles sont victimes. Basile de Bure le reconnaît : « ces ateliers ont changé ma vie et ma vision de la société et de la justice. J’ai sûrement plus appris d’eux que l’inverse ».
Enora Foricher @EnoraForicher
Alexis Gonzalez @algonzlz
Zoé Moreau @MoreauZo2